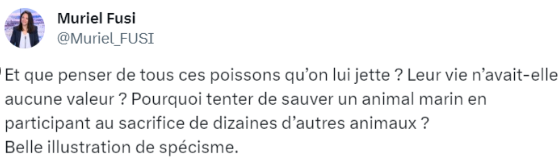Qu’est ce que sont les espèces clef-de-voûte ?
Voilà un concept familier pour beaucoup d’amoureux de la nature : l’espèce clef-de-voûte. Ce maillon capital de tout écosystème s’est imposé comme un incontournable de la protection de la biodiversité.
Mais savez-vous vraiment ce que c’est ?
Il s’agit d’une espèce qui joue un rôle fondamental pour l’écosystème auquel elle appartient. Elle se caractérise par un effet et une importance disproportionnée par rapport à son abondance.
Cela en fait un élément aussi fragile que capital : il est difficile de repérer une espèce clef-de-voûte dans un écosystème, mais son déclin entraînerait l’effondrement de celui-ci.
L’action des espèces clef-de-voûte est souvent originale : aucune autre espèce de l’écosystème ne peut alors remplir le rôle qu’elles occupent, leur spécificité fait leur importance.
Les loutres de mers des forêts de varech (ou kelp) en sont un des exemples les plus connus. Le déclin de ces animaux a mis en danger cet écosystème du Pacifique.
En effet, faute de prédateurs, les oursins, infatigables dévoreurs de varech, pullulèrent. Ce succès des oursins mit en danger tout l’écosystème, et seul le retour en force des loutres inversa la tendance.
L’exemple des loutres est particulièrement emblématique en ce qui concerne le levier d’action de l’espèce clef-de-voûte. Le cas de prédation d’un grand brouteur est effectivement le cas le plus courant.
Néanmoins, il existe d’autres rôles très importants : la pollinisation ou la dispersion de graines en sont des exemples.
On peut également évoquer les espèces ingénieurs. Ces dernières ont un grand pouvoir de modification de leur environnement.
On peut citer le castor dans ce rôle. Capable de faire apparaître des étangs autour d’un cours d’eau en quelques jours, sa quasi disparition d’Europe a beaucoup changé l’allure de nos cours d’eaux.